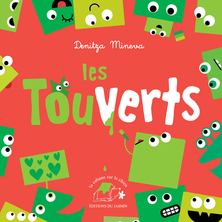Extrait du livre Les compagnons du Flamboyant
Les compagnons du Flamboyant de Marie Potancq aux éditions du Jasmin
Les compagnons du Flamboyant
1 Juillet 1760 Élodée de Kergoet se réveilla en sursaut avec une étrange sensation à l’intérieur du corps. Encore engluée de sommeil, elle essaya de se concentrer sur le point douloureux. C’était là, un peu au-dessus du nombril − l’impression d’une boîte vide où s’agitait un petit rongeur. Mais pouvait-on contenir une boîte vide ? Élodée n’était pas très douée en anatomie, mais elle doutait qu’on puisse avoir un coffre à l’intérieur du corps, surtout un coffre où serait enfermé un rat. D’abord parce que le raton, il aurait fallu l’avaler, pouah ! Il n’y avait plus grand-chose dans le garde-manger, c’était un fait. Mais elle n’en était pas encore au point d’attraper les souris pour les manger. Non, c’était autre chose. Elle s’assit dans son lit et rejeta ses cheveux en arrière. Il faisait une chaleur d’étuve, comme souvent en cette saison, quand la petite mousson se faisait attendre. À travers la moustiquaire, elle jeta un regard sur l’horloge, qu’éclairait
la flamme de la veilleuse. 4 h du matin. Le jour n’allait pas tarder à poindre. — Oooouh… bâilla-t-elle, la bouche grande ouverte. Elle sentit de nouveau le vide, là, sous sa main. Et brusquement, elle comprit. Pour la première fois de sa vie, Élodée avait faim. Une sensation si étrangère qu’elle avait eu du mal à l’identifier ! Oh, bien sûr, il lui était déjà arrivé d’éprouver une vive envie de manger, par exemple quand un repas était déjà loin et qu’elle attendait avec impatience le suivant. « J’ai le ventre creux », disait-elle en riant. « Mange ton pouce et garde l’autre pour demain ! » lui répondaient ses sœurs sur le même ton. Car cette impression-là, tout le monde la connaît, n’est-ce pas ? Mais cette fois, c’était différent. Elle avait faim parce qu’elle n’avait pas assez mangé. Incapable de se rendormir, elle souleva la moustiquaire et posa les pieds sur le tapis disposé près de son lit. Par la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur le jardin, elle entendait crisser et grésiller les mille insectes de la nuit. Mais ici, dans la maison, tout était silencieux. Ses sœurs devaient dormir dans leurs chambres ouvrant sur le patio, comme dormaient Meena et le petit Muthu dans les godons, le bâtiment des serviteurs. D’un geste précautionneux, elle alluma son bougeoir à la mèche du lumignon, dont la flamme tremblotait dans une coupelle. Puis elle se glissa dehors en écartant le rideau qui servait de porte et traversa la galerie pour gagner la cuisine. Une touffeur humide régnait dans la pièce et son premier soin fut de relever le store de bambou qui fermait la fenêtre. Elle posa ensuite sa bougie sur une table et jeta un coup d’œil autour d’elle. La veille, Meena leur avait servi du riz avec un peu de chutney. Peut-être en restait-il un fond quelque part ? Mais elle eut beau se hisser sur la pointe des pieds pour inspecter le fond des chaudrons, elle trouva tous les récipients désespérément torchés. Rien, pas même un restant de pâte à chappattis, qu’elle aurait dévorée crue dans sa fringale. Même le fruitier sonnait creux ! Elle refermait la porte du garde-manger, quand un bruit de pas retentit derrière elle. — Tiens, c’est toi ! Que fais-tu là ? — Et toi ? Rose se mit à rire. C’était l’aînée des filles Kergoet et aussi la plus jolie, avec ses bouclettes d’or et ce regard de myosotis que lui enviait tant Elodée. Elle avait passé un déshabillé sur sa chemise de mousseline et enfilé des mules. — J’ai faim, expliqua-t-elle, ça m’a réveillée. Toi aussi, je suppose ? — Oui, mais il n’y a rien à manger. — Tu as regardé partout ? — Oh, oui ! Il doit rester un sac de riz dans la resserre, mais c’est Meena qui a la clef. On ne va pas la réveiller à cette heure. Rose réfléchit. Elle fronçait toujours le nez dans ces moments-là, comme les petits macaques qui s’introduisaient parfois dans le jardin. Mais elle était si jolie que même cette mimique n’arrivait pas à l’enlaidir. — Et si on se faisait du thé ? — Il n’y a plus une goutte de lait. — Eh bien, nous ferons du thé à l’eau. Va remplir la bouilloire à la fontaine, pendant que je rallume le brasero.
Il leur fallut un bon quart d’heure pour chauffer l’eau. Malgré la fenêtre béante, l’air de la pièce était devenu irrespirable avec la chaleur du feu. Le front en sueur, Élodée regarda sa sœur ébouillanter la théière avant de la remplir. Et dire que quelques semaines plus tôt, elles n’auraient même pas su trouver la boîte à thé ! Mais les événements les avait obligées à se prendre en charge. Encerclé depuis des mois par les Anglais, Pondichéry avait entamé en juin ses dernières réserves et la famine n’avait pas tardé à s’abattre sur ses habitants. Les gens tombaient comme des mouches et ceux qui étaient encore valides tentaient de fuir par tous les moyens. C’était ainsi que les domestiques avaient peu à peu déserté la maison. Le majordome avait été le premier à décamper. Sur la centaine de serviteurs que comptait jadis la maisonnée, il ne restait plus que leur aya et Muthu, le petit orphelin que Meena avait recueilli après la mort de ses parents. — Il n’y a plus de sucre, observa Elodée. Juste un vieux fond de mélasse. — Ça fera l’affaire, affirma Rose. Elle jeta une pincée de thé dans l’eau frémissante et posa le couvercle sur la théière en porcelaine. — Et si on montait le boire sur l’argamasse ? — Ça, c’est une bonne idée ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quelques instants plus tard, elles étaient assises en tailleur sur le toit-terrasse, de chaque côté de la table basse où Rose avait disposé le plateau. Au-dessus d’elles, le ciel déployait sa voûte nocturne où scintillaient des pâquerettes d’or. Élodée avala une gorgée de thé. — Tout a l’air comme avant, observa-t-elle, songeuse. Et pourtant ça ne fait pas vrai. — Que veux-tu dire ? — Eh bien, tout semble normal, mais en réalité, rien ne l’est plus ! Elle avait du mal à exprimer ce qu’elle ressentait. Prendre le thé avec Rose, c’était une de ces choses qu’on faisait jadis tous les jours sans se poser de questions. Mais siroter le breuvage en pleine nuit sur l’argamasse pour tromper la faim qui leur rongeait l’estomac, cela n’entrait pas dans l’ordre normal des choses. À supposer qu’il y en ait encore un… — Bois donc tant que c’est chaud, intima Rose, qui n’avait pas la moindre inclination pour la philosophie. Élodée étouffa un soupir. Margot, elle, aurait tout de suite compris ce qu’elle voulait dire et l’aurait aidée à exprimer sa pensée. Bien qu’elle n’eût que onze ans, c’était la savante de la famille, celle qui lisait le sanscrit et pouvait réciter à l’envers la liste de tous les rois de France et même des empereurs romains. Rose repoussa de son front ses boucles moites de sueur. — Si seulement papa n’était pas si loin ! soupira-t-elle. Il faudrait qu’il revienne vite, sans quoi… — Vite ? Sa dernière lettre a été envoyée de l’Isle de France. Il faudrait déjà savoir s’il a atteint les côtes de Bretagne. Et il ne peut pas en repartir avant l’hiver. C’est entre décembre et mars que les bateaux appareillent de Lorient. Rose touilla la mélasse au fond de sa tasse, puis lécha sa cuillère. Ce n’était pas très protocolaire et quelques semaines plus tôt, la gouvernante n’aurait pas manqué de la gronder pour ce geste. Seulement il n’y avait plus de gouvernante. Effrayée par l’approche des Anglais et les menaces de famine qui
planaient sur la ville, Mlle Deler avait filé quinze jours plus tôt, abandonnant ses élèves. — Même s’il arrive à régler ses affaires, il lui faudra bien rester deux ou trois mois en Bretagne, poursuivit Elodée. Puis il y aura tout le trajet de retour. Elle compta sur ses doigts. — Trois mois plus cinq… Elle exhala un soupir. — Et encore, si tout va bien ! À mon avis, on ne peut pas compter sur son retour avant un an. Un instant de silence suivit ces propos. Élodée fut tout à coup effrayée par le sens de ses propres paroles. Un an, mon Dieu, un an… Comment survivre pendant tout ce temps, surtout si les Anglais s’emparaient de la ville ? Elle vida le fond de la théière dans leurs tasses, puis renifla. — Aussi, pourquoi a-t-il fallu qu’il nous quitte ? C’est notre père, il devrait être là pour nous protéger, non ? — Tout allait bien quand il est parti. Comment aurait-il pu se douter ? Élodée en convint. C’était injuste d’en vouloir à leur père. Comment aurait-il pu savoir que la défaite de LallyTollendal à Vandivachy allait ouvrir le sud du sous-continent aux Anglais ? — Et puis il y avait cet héritage, poursuivit-elle. Une histoire de legs et de manoir, là-bas, à Troamboul, au fond de la Bretagne… Élodée avait du mal à les imaginer, ces landes bretonnes que teintaient de mauve les plaques de bruyère autour des granites pointant vers le ciel. De la France, Rose et elle ne connaissaient presque rien. Rose n’était pas née quand François de Kergoet, leur père, s’était embarqué de Lorient pour aller chercher fortune aux Indes. Pondichéry était alors au sommet de sa splendeur, c’était le temps du gouverneur Dupleix, l’époque des conquêtes et des rêves. Kergoet avait vite gagné ses galons au service de la toute-puissante Compagnie des Indes. Brillant officier, il s’était enrichi en pratiquant, comme tant de ses compatriotes, le commerce d’Inde en Inde, frétant des navires qui transportaient pour son compte des soieries et ces fameuses indiennes dont les tisserands tamouls conservaient jalousement le secret. Son mariage avec la fille d’un conseiller, Isabelle Denon, avait achevé de le poser dans la société locale. Rose était née en 1747, puis Élodée, Marguerite et Aster. Mon bouquet de fleurs, les appelait-il avec tendresse. Mais le bonheur n’avait eu qu’un temps. Sous l’impitoyable soleil des Indes, Isabelle n’avait pas survécu à ses grossesses répétées. Consumée d’une fièvre lente, elle s’était éteinte en 1753, peu après la naissance d’Aster. Élodée gardait un souvenir confus de sa mère. Parfois, quand elle s’endormait, elle avait l’impression qu’un visage de femme se penchait au-dessus de son lit. Il n’y avait pas de portrait de la défunte dans la maison et c’était sans doute mieux ainsi. De sa mère, comme de la lointaine Bretagne, elle ne savait rien, hors les descriptions que leur en faisait son père. Grande, un peu sauvage, bleue et grise… Pour elle, le pays se confondait avec la femme. Sa mère ne reposait pas sous la stèle blanche du cimetière colonial, elle était retournée là-bas, au pays du soleil couchant, dans la fraîcheur du crachin breton et les envols criards des mouettes. — N’empêche… soupira-t-elle. Il n’aurait pas dû nous laisser ainsi !
Rose acheva son thé en allongeant la langue pour atteindre la mélasse au fond de la tasse. — Il comptait sur Desourt. Comment aurait-il su que son ami tomberait aux mains des Anglais à Valdaour ? — On dit qu’ils vont l’envoyer en prison en Angleterre. Tu crois que c’est vrai ? — Comment pourrais-je le savoir ? Ce qui est sûr, c’est que Desourt ne pourra pas veiller sur nous comme Père le lui avait demandé. Nous sommes seules à présent. Elodée sentit son cœur se serrer. Seules… Comment était-ce possible ? Il y avait toujours eu tant de monde autour d’elles ! Leur père et leurs amis, bien sûr, mais aussi des dizaines et des dizaines de serviteurs − majordomes, cuisiniers, bonnes d’enfants, soubrettes, gardiens et porteurs de palanquin… Nuit et jour, la maison grouillait de monde, on entendait claquer les pieds nus des domestiques sur les dalles et résonner les rires étouffés des ayas. — Il nous reste Meena, murmura-t-elle. Et Muthu. — Meena ne peut pas tout faire. Et Muthu n’est qu’un enfant. Pendant quelques instants, le silence régna sur la terrasse. Puis Élodée soupira dans le noir. — Tu as pensé à ce qui se passera si les Anglais prennent la ville ? — Bon sang ! Tu crois que je peux l’oublier un seul instant ? J’en ai des cauchemars la nuit ! Elles se turent un instant, immobiles devant leurs tasses vides. Aucune des deux n’avait envie de retourner se coucher. Il faisait trop chaud, il y avait trop de tristesse et d’inquiétude dans leur cœur. Oui, songeait Elodée. Qu’allons-nous devenir ? Bientôt, il y aurait des décisions à prendre et personne ne serait là pour le faire à leur place. Mais elles n’étaient que des enfants, bonté divine ! Margot avait onze ans et Aster, la petite dernière, à peine huit. Toujours, il y avait eu quelqu’un pour veiller sur elles, leur dire ce qu’il fallait faire et guider chacun de leurs pas. Et à présent… La gorge nouée, elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles commençaient à pâlir. Une musique lointaine montait d’un temple, et dans le jardin, les milliers d’insectes faisaient vibrer leurs élytres avec une vigueur accrue, comme pour saluer la naissance du jour. Bientôt, perruches et colibris se joindraient au concert, mêlant au chœur leurs cris discordants. Et sur la margelle du bassin, le martin-pêcheur guetterait les poissons, son plumage bleu roi reflété dans l’onde miroitante. Élodée ferma les yeux, les mains pressées sur sa poitrine. Il était là, autour d’elle, ce monde tropical où elle avait passé son enfance auprès de tous ceux qui lui étaient chers. Ces criaillements d’oiseaux, ces couleurs, cette vie qui pullulait partout… Elles empilaient les tasses et les soucoupes avec force bâillements, quand un coup sourd retentit soudain dans la ville endormie. Élodée sursauta et faillit lâcher la théière. — Qu’est-ce que c’est ? Rose courut vers la balustrade et scruta l’obscurité. Autour d’elles, le concert du jour naissant s’était tu d’un coup. Même le jardin semblait en attente, comme si arbres, insectes et oiseaux avaient compris avant elles ce qui se passait. Élodée se levait à son tour, quand une deuxième détonation la fit sursauter.
— C’est là-bas, du côté de Vilnour… Elles échangèrent un regard dans la pénombre. Elodée s’éclaircit la gorge. — C’est le canon, n’est-ce pas ? Les Anglais doivent être assez près pour tirer à présent. Elles levèrent les yeux, instinctivement, vers le ciel pâli par l’approche de l’aube. Jamais de leur vie elles ne s’étaient senties aussi seules, aussi désemparées. — Qu’est-ce qu’on va faire ? murmura Rose. Ça veut dire que le siège va commencer. Ils vont fermer les portes de la ville. Cette fois, il n’y aura vraiment plus rien à manger ! Un troisième coup de canon ponctua la phrase. Élodée n’hésita plus. — Si tu veux mon avis, il faut déguerpir d’ici. Et vite ! 2 Rose, livide, dévisageait sa sœur. — Partir ? Mais comment ? Les Anglais sont presque aux portes de la ville. Il faut demander de l’aide… — À qui ? — Je ne sais pas, les amis de papa. Ils ne sont pas tous partis, que je sache. Envoyons Meena au palais du gouverneur, quelqu’un la renseignera. — Non. — Comment ça, non ? Tournée vers la balustrade, Élodée désigna d’un geste la masse sombre en contrebas − la Ville Noire, déjà abandonnée par la moitié de ses habitants, et où l’autre moitié mourait de faim. Les faubourgs, où venaient de s’abattre les premiers boulets de canon. La mer, où croisaient les frégates anglaises. Le monde autour d’elles, qui n’était plus que chaos. — Tu crois qu’ils n’ont pas déjà fait assez de mal comme ça ? — Qui donc ?
— Les soldats, le gouverneur, les amis de papa, tous ! Ah, ils sont bons pour nous faire la leçon, ça oui ! Et ne faites pas ceci, mesdemoiselles ! Et ne dites pas cela ! Fi, c’est très vilain à vous de vous comporter ainsi ! Elle agitait l’index, imitant le ton d’une gouvernante morigénant ses élèves. Rose l’écoutait, sidérée. — Qu’est-ce qui te prend ? Tu es folle ! Mais Élodée était lancée. Il y avait trop longtemps qu’elle couvait sa colère. — Mais eux, que font-ils, hein, les beaux parleurs ? Mlle Deler a été la première à prendre la poudre d’escampette, dès que les choses se sont gâtées. Et les autres ont filé aussi. Est-ce qu’ils se sont souciés de ce que nous allions devenir ? Sa voix tremblait à présent. Elle énuméra en comptant sur ses doigts : — M. de Lahaye, qui devait passer nous voir tous les jours et que nous n’avons pas vu depuis des semaines… La mère Labilarière, qui se soucie de nous comme d’une guigne… Le lieutenant de Karann… Lesourt… — Ah, non, ne dis pas de mal du lieutenant ! Il nous rend visite chaque fois que son service le lui permet. Quant à Lesourt, tu ne vas quand même pas lui reprocher de s’être fait prendre par les Anglais ? — Si ! Il n’avait qu’à penser à nous avant d’aller risquer sa vie. Il avait une responsabilité. Et je ne parle pas des autres − les serviteurs, les ayas qui nous berçaient quand nous étions petites. Même papa nous a laissé tomber ! — Arrête, Elodée ! Ils… ils ont leurs raisons, je suppose. Nous sommes trop jeunes pour comprendre. Élodée secoua la tête. — Oui, c’est ce qu’ils disent tous. C’est tellement plus facile, n’est-ce pas ? Elle renifla et sortit de sa manche un mouchoir de batiste, dans lequel elle se moucha vigoureusement. Voilà, c’était fini. Au moins, elle avait dit ce qu’elle avait sur le cœur. Mais rien n’était résolu pour autant, les deux sœurs en étaient bien conscientes. — Bon, que faisons-nous maintenant ? Élodée réfléchit. — Je ne vois qu’un endroit… — Verterive ? Élodée hocha la tête. Verterive, c’était la maison de campagne que leur père avait fait construire au nord-ouest de Pondichéry, sur la berge de la rivière Ariancoupam. Une tope, comme on disait à Pondy. Jeune marié, il allait s’y rafraîchir avec Isabelle pendant la saison chaude, quand les vents de terre brûlants soufflaient sur la ville. Et plus tard, il avait continué à y amener ses filles, au fort des chaleurs d’été. La maison des Dupleix s’élevait tout près de là, à Murratandi, et le gouverneur et son épouse leur rendaient parfois visite en voisins, durant ces soirées de mai où l’on dégustait de petits gâteaux au lait dans des feuilles de banyan cousues avec des tiges. Le souvenir de ces friandises fit venir l’eau à la bouche d’Élodée. Mais ce n’était pas le moment d’écouter son estomac ! — Partons pour Verterive. Au moins, là-bas, nous aurons le verger. Nous pourrons manger des fruits si nous n’avons rien d’autre. — Partir, c’est bien joli. Mais comment ? Nous n’avons plus de moyen de transport. On ne va tout de même pas
y aller à pied ! Nous deux, à la rigueur, nous pourrions marcher. Mais les petites… — Il nous reste le palanquin… — Et les porteurs ? Élodée fronça les sourcils. Il y avait déjà plusieurs semaines que leurs boués les avaient quittées, comme les autres serviteurs. Pour porter un palanquin, il fallait au moins cinq hommes, deux devant et trois à l’arrière. Quand elles voyageaient avec leur père, c’étaient deux douzaines de boués qui les suivaient dans leurs déplacements, se relayant pendant tout le trajet. Pas de porteurs, pas de palanquin ! — Demandons à Meena. Elle a de la famille dans la Ville Noire. Peut-être pourra-t-elle nous trouver quelques hommes pour porter le palanquin. Verterive n’est qu’à une lieue d’ici après tout. — Et l’argent ? Il faudra les payer ! — Il doit bien rester assez sur la somme que papa a laissée. Allons voir dans le coffre. Oubliant le plateau à thé, elles descendirent l’escalier de l’argamasse, guidées par les premières lueurs de l’aube qui éclairaient les marches. Parvenues devant la bibliothèque, elles allumèrent le chandelier posé sur une tablette près du seuil et poussèrent la porte. Depuis le départ de son père, Élodée avait du mal à pénétrer dans cette pièce, où le souvenir de François de Kergoet était encore si présent. La mappemonde qu’il faisait si souvent tourner devant elles pour pointer du doigt cette avancée de terre brune dans le bleu de l’océan (« le Finistère, mesdemoiselles ! »), les étagères en teck avec les livres familiers, le buste du roi de France posé sur la console ; et le bureau, avec son désordre de plumes, d’encriers et de papiers… Même l’odeur parlait de lui. Un mélange de cuir, de tabac et de cette poudre parfumée dont il usait pour ses perruques… Élodée déglutit. Ce n’était pas le moment de se laisser attendrir ! Déjà, Rose retirait du tiroir la petite clef suspendue à un cordon de soie. Le coffre s’ouvrit sans difficulté et elles rabattirent le couvercle. Dans un coin, entre des écrins à bijoux et une pile de documents, elles découvrirent deux sacs de cuir, qu’elles vidèrent à même le sol. Des pièces roulèrent sur le parquet. Fanons d’argent, billons de cuivre, et même quelques précieuses pagodes d’or… Fascinées, elles les éparpillèrent sur le tapis. — Il y en a beaucoup, chuchota Rose. Papa devait craindre que nous ne manquions… — C’était beaucoup, oui… quand il est parti ! À présent que les vivres ont tellement enchéri, on ne doit pas pouvoir acheter grand-chose avec tout cet argent. Meena se plaint du prix de tout, elle dit qu’on n’a plus rien avec un fanon. Un boisseau de riz coûte une fortune ! — Tout de même, il devrait y avoir assez pour payer des porteurs. — Espérons-le ! Leur trésor sous le bras, elles sortirent de la bibliothèque, dont elles refermèrent soigneusement la porte. — Et maintenant ? Comme pour leur rappeler l’urgence de la situation, un nouveau coup de canon retentit au loin. Rose se reprit. — On dirait que ça s’est rapproché ! Elles traversaient le patio, quand une petite silhouette accourut à leur rencontre.