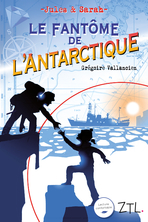Extrait du livre L'espoir en bandoulière
L'espoir en bandoulière de Grégoire Vallancien aux éditions ZéTooLu
L'espoir en bandoulière
Préface La petite résistante nantaise « C’était aussi cela, entrer dans la Résistance : faire de toutes petites missions, apparemment anodines, sans gloire ni panache, mais qui pouvaient être décisives pour la suite. Suzanne le savait, elle était devenue un rouage dans une grande machine complexe et secrète. Elle s’opposait à l’occupation de la France par les nazis ». La guerre, ce n’est pas qu’une histoire de grands et de militaires, de combats et d’armes, nous rappelle judicieusement l’auteur Grégoire Vallancien dans ce roman lumineux. La guerre touche toutes les générations, les milieux sociaux, brise des vies, des destinées et s’immisce dans les familles sans prévenir. Parmi ces gens, des anonymes luttent, des petites mains
s’entraident, des Justes se révèlent. Beaucoup ont disparu dans les oubliettes du temps. L’héroïne de L’Espoir en bandoulière a pour prénom Suzanne. C’est une élève de l’emblématique lycée nantais Guist’hau, passionnée par la photographie. C’est avec elle que nous marchons dans Nantes, ville occupée, cadenassée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1944. L’adolescente, qui devient résistante par rage de se sentir impuissante, comprend vite le drame qui se noue et les enjeux de ce monde chaotique qui l’entoure. Avec Pierrick, médecin à l’Hôtel-Dieu, et sa compagne Colette, ou encore son professeur d’histoire, ils vont se démener dans cette armée de l’ombre et donner bien du fil à retordre aux envahisseurs. Les lois antijuives et la violence règnent, la tragédie des otages bouleversera les Nantais. La Gestapo (police politique de l’Allemagne nazie) et ses sbires ont aussi leurs indicateurs, des collabos. Gare à celui ou celle qui se fera repérer, arrêter. La torture et la mort rôdent. Dans ce texte qui touche à l’universel, humaniste et plein d’espoir, Grégoire Vallancien nous fait vivre les tristes heures de la cité des ducs de Bretagne. Avec réalisme, il décrit les bombardements qui ont meurtri Nantes et tué près de 1 500 habitants au cours du mois de septembre 1943. Avec ses personnages attachants, la petite histoire entre dans la grande. Elle permet à chacun et chacune, par le biais de la fiction, de mesurer et de comprendre cette tragédie pour aborder autrement le présent. Les leçons du passé, comme nous le montre la guerre actuelle en Ukraine, ne sont, hélas, pas forcément apprises par tous les hommes. Comme le dit si bien Jacques Prévert, « quelle connerie la guerre ». Mais, à l’image de Suzanne, la petite résistante du collège Guist’hau, gardons l’espoir en bandoulière ! Stéphane Pajot, journaliste et écrivain
Première partie Septembre 1942 - juin 1943
-I Il était minuit passé. À Nantes, le Jardin des Plantes était encore humide des pluies précédentes et entièrement plongé dans l’obscurité brumeuse de cette nuit de septembre. Un homme courait à travers les allées, trébuchant, se relevant, cherchant à fuir. Il entendait des coups de sifflet au loin, des cris, les aboiements rauques et menaçants des chiens lâchés à sa poursuite. Il n’avait plus de souffle. Il devait s’arrêter, se cacher pour réfléchir. Depuis la gare, il avait traversé le boulevard Sébastopol, trouvé ce jardin et en avait escaladé la grille, se pensant à l’abri. Accroupi, tout tremblant, il prit son appareil photo. Il sortit la pellicule avec délicatesse. Elle était précieuse,
il le savait, il allait mourir pour elle ! Alors, il la jeta dans les buissons le plus loin possible, comme une bouteille à la mer. C’était son dernier geste de combattant. Puis il reprit sa course, fit quelques foulées encore pour sentir son cœur battre. Regarder la lune, une dernière fois. Les cris se rapprochaient. Il était encerclé ! La lumière des lampes torches l’éblouit. Il ne bougea plus. Il croqua sa pilule de cyanure, rapidement avant de trop réfléchir. Un goût amer coula dans sa bouche. Il sourit à l’officier de la Gestapo qui s’approchait de lui. Celui-ci le regarda durement ; une longue cicatrice barrait son visage émacié, accentuant encore son expression de fureur. Mais c’était trop tard, l’homme avait gagné : il leur avait échappé ! Il s’effondra sur le sol, victorieux dans sa défaite. Cette guerre se finirait sans lui. • De retour à son bureau de la place du Maréchal-Foch, l’officier Klaus Hammer, le chef de la Gestapo de Loire-Inférieure, fit un rapport. Il aurait été préférable d’arrêter cet homme vivant. Cependant, l’agent britannique des services secrets n’avait pas de pellicule photo en sa possession. Avait-il pu prendre des photos de la liste Goethe ? Avait-il pu se séparer de la pellicule ? C’était bien possible mais l’officier jugea plus prudent d’affirmer le contraire à l’Abwehr, le service de renseignement militaire de la Wehrmacht. Dehors, le bruit lugubre d’une sirène vibrait dans le lointain ; puis une autre résonna à l’unisson. Klaus Hammer regardait, derrière les toits d’ardoises luisantes, pointer l’aurore grise. • Cette fois-ci, le bruit venait de l’église Sainte-Croix. C’étaient les sirènes d’alerte aérienne. Suzanne s’extirpa difficilement de la chaleur de son lit. Elle sortait d’un rêve où il n’était question ni de guerre, ni d’occupation, encore moins de restriction alimentaire. C’était la vie d’avant, insouciante et libre, lorsqu’on était en paix et que son père habitait à la maison. Ces temps heureux paraissaient si lointains maintenant, que Suzanne doutait même qu’ils puissent revenir un jour.
Dorénavant, elle vivait dans un pays occupé par les Allemands et bombardé par les Anglais qui continuaient le combat. Elle se leva et enfila en hâte un cardigan, une robe de chambre, des chaussettes et des pantoufles. C’était la première fois qu’elle descendait de nuit à la cave et fin septembre, les nuits commençaient à rafraîchir. — Allez debout ! Jean, on se dépêche, il faut descendre, les houspilla leur mère. Suzanne regarda par la fenêtre de la chambre, la ville semblait étrangement calme. Seules les sirènes hurlaient obstinément. — Si c’est comme ça, moi je me recouche, dit son grand frère en bâillant. Les Anglais bombarderont peut-être les usines mais pas le centre-ville. — Tu descends avec nous ! hurla sa mère en l’attrapant par le col et en le traînant jusque sur le palier. Il n’eut pas le temps de lacer ses chaussures ni de prendre une veste et dut enfiler son pantalon dans l’escalier, directement sur son pyjama. Les Martin arrivèrent du bout du couloir où ils logeaient avec leur fille de 6 ans qui dormait dans les bras de son père. Suzanne avait pris une valise avec les papiers importants, de l’argent, de quoi se changer si nécessaire, ainsi que son bien le plus précieux : son appareil photo. Puis, elle y glissa une enveloppe remplie de clichés qu’elle avait réalisés elle-même. — On ne sait jamais, dit-elle comme pour s’excuser, si ça se trouve, l’immeuble va être bombardé. — Vous êtes gaie, Mademoiselle, ironisa madame Martin. — Malheureusement, ma fille a raison, dit Yvonne, s’il n’y avait aucun danger, pourquoi descendrions-nous à la cave ? Je vous le demande ! Soudain, le bourdonnement des avions qui survolaient la ville se fit entendre, puis ce fut le bruit lointain des tirs de DCA, qui leur rappela la présence du danger. — Il paraît qu’ils sont sur les Batignolles, dit un vieux monsieur en robe de chambre qui n’en savait évidemment rien...
L’escalier de la cave était étroit avec des marches de pierre si usées qu’elles en devenaient glissantes. Jean prit la valise et aida sa sœur. Elle avait un pied bot* et marchait avec une canne, ce n’était pas très commode pour elle. Les concierges avaient aménagé la cave suivant les instructions que la défense civile avait données. Des banquettes et quelques chaises étaient alignées le long d’un mur. Des bougies, des couvertures, des réserves alimentaires et des masques à gaz étaient stockés en permanence dans un coffre. Tout le monde prit place, en silence, anxieux, guettant les moindres bruits qui venaient de l’extérieur, essayant de les interpréter. Des explosions se faisaient entendre ; la lumière des trois ampoules qui pendaient du plafond vacillait, comme un mauvais présage. Quelque part dans le ciel, très haut, au-dessus d’eux, des avions larguaient leurs obus meurtriers. Une vieille femme, veuve de la Première Guerre mondiale, priait tout bas, un chapelet à la main. Elle récitait en boucle des Je vous salue Marie. Des garçons d’une dizaine d’années qui habitaient l’escalier B, de l’autre côté de la cour, jouaient au fond de la cave dans un coin sombre. — Attention ! se fâcha leur mère, il y a des rats par là-bas. — Et surtout, ajouta le concierge, cette partie n’a pas été consolidée ; si l’immeuble nous tombe dessus, vaudrait mieux pas traîner dans ce coin. Les bruits de tirs de DCA étaient de plus en plus proches. — C’est le poste de la rue des Trois-Croissants qui réplique, expliqua un homme d’une cinquantaine d’années. Je suis de la Défense passive, précisa-t-il en appuyant son doigt sur sa poitrine pour se désigner. — Dans ce cas, c’est que les bombardiers reviennent sur la ville, dit un autre homme, en s’allumant une cigarette. Ils étaient plusieurs à fumer dans un coin en discutant. Deux d’entre eux affirmaient que les Anglais étaient des lâches. — C’est facile de bombarder les civils depuis leurs forteresses volantes !
Au bout d’un quart d’heure, le ronronnement des avions sembla s’éloigner. Suzanne tendit l’oreille : plus un bruit. Lorsque la fin de l’alerte fut sonnée, chacun remonta se coucher, soulagé et en même temps contrarié d’avoir été dérangé dans son sommeil. — Déjà qu’on n’a plus rien à manger, si on ne peut même plus dormir ! râla monsieur Martin en grimpant ses six étages. Suzanne retourna se coucher en bâillant. Elle allongea ses jambes sous ses couvertures et s’endormit sans même s’en rendre compte. Elle venait de fêter ses 15 ans et elle vivait dans un pays en guerre. -II La bouilloire sifflait sur la gazinière. Dehors, une lueur matinale pointait sous un ciel de traîne qui annonçait une belle journée. Suzanne entra dans la cuisine, pieds nus, en chemise de nuit. Elle bâillait à s’en décrocher la mâchoire, la nuit avait été courte. Sa mère était déjà partie. Elle avait laissé un mot : Je reviens pour déjeuner. Je t’embrasse. Maman Après avoir avalé un quignon de pain et un bol de chicorée, Suzanne se lava dans la bassine avec un savon de mauvaise qualité que leur voisine faisait elle-même. C’était gentil de sa part, mais il ne moussait pas et, pire encore, il sentait mauvais.